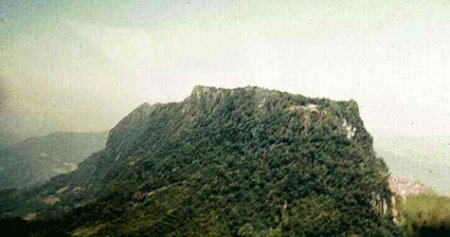Publié le 6 March 2010, dans la rubrique Intelligence stratégique..
 Send
Send En 1965, les Etats-Unis mènent une véritable guerre au Laos contre le parti communiste local, le Pathet Lao, pour le contrôle de la partie nord du pays -où est située en particulier la fameuse Plaine des Jarres (1). En raison de restrictions concernant l’emploi de la force armée dues à des accords de paix signés en 1962, cette guerre est du ressort quasi exclusif de la CIA, alors que les Nord-Viêtnamiens ont maintenu 7 000 combattants, après la signature des accords de paix, au Laos. Les Américains choisissent donc d’agir de manière clandestine en épaulant l’armée royale laotienne.
L’US Air Force intervient en soutien de ces opérations : au nord, « Barrel Roll » (2) fournit un appui aérien rapproché aux troupes amies, tandis qu’au sud « Steel Tiger » (3) s’en prend à la piste Hô Chi Minh utilisée par les Nord-Viêtnamiens comme voie logistique vers le Sud-Viêtnam. Cette guerre est alors considérée comme secrète car le public américain n’est pas informé de ces opérations, bien que la presse américaine et le Congrès s’en fassent souvent l’écho.
Samneua est une des clés de ce champ de bataille, car c’est une des portes d’entrée entre le Laos et le Nord-Viêtnam : Hanoï s’en sert pour infiltrer des troupes au Laos, et plus au sud, tandis que les Américains l’utilisent comme plateforme de surveillance et d’opérations de reconnaissance au Nord-Viêtnam. En août 1966, pour soutenir l’effort aérien contre le Nord-Viêtnam, une Tactictal Air Navigation Station (TACAN) est construite sur le sommet de la montagne proche du Lima Site (pour Landing Site) 85. Connue sous le nom de Phou Phathi pour les Laotiens, la montagne se trouve à 250 km à l’ouest d’Hanoï et à seulement 40 km de Samneua, capitale du Pathet Lao. Pour les montagnards hmongs et yao, cette éminence renferme des esprits qui exercent une influence surnaturelle sur leurs destinées. Pour l’ambassadeur américain, Sullivan, qui dirige la guerre secrète au Laos, l’installation d’une telle station se fait trop près d’une place forte ennemie, et par ailleurs il faut en assurer la défense alors que les moyens existants sont déjà très sollicités ailleurs.
Une installation stratégique
La station a été installée là car elle est à portée radar et radio du Nord-Viêtnam. Dans la région, avec le déclenchement de la mousson de nord-est en octobre, le mauvais temps rend toutes les opérations aériennes difficiles jusqu’au mois d’avril. C’est un problème essentiel pour l’opération Rolling Thunder, la campagne de bombardement déclenchée contre le Nord-Viêtnam par les Américains depuis 1965. L’US Air Force dispose alors de deux appareils capables de mener des opérations par mauvais temps : le A-6 Intruder et le B-52 Stratofortress. Mais le premier est alors disponible en nombre limité (4) et des contingences politiques limitent le second à des frappes près de la zone démilitarisée (DMZ) à la frontière entre le Sud-Viêtnam et le Nord-Viêtnam. Cela laisse aux F-105 et autres appareils tactiques le soin de frapper ce dernier, ce qu’ils ne peuvent faire que 4 ou 5 jours par mois pendant la mousson.
La TACAN est en fait un transmetteur radio autonome qui fournir aux avions de combat le relèvement et la distance en miles de la station. Plusieurs techniciens assurent la maintenance de la station et du générateur qui lui y est associé. Toutes les semaines, le « Rocher » est ravitaillée par une Air Commando Unit, baptisée PONY EXPRESS, basée à Udorn en Thaïlande. En 1967, la station est améliorée par l’ajout d’un radar de contrôle de bombardement pour accroître l’efficacité de la campagne aérienne contre le Nord-Viêtnam. Du personnel supplémentaire de l’US Air Force, réembauché par une compagnie civile, et de véritables ingénieurs civils de Lockheed Aircraft, opèrent alors sur place. 44 hommes et 4 officiers se sont portés volontaires pour cette opération baptisée « Heavy Green ». Des équipes CIRCUIT RIDERS du 1st Mobile Communication Group de l’USAF basé à Udorn tournent toutes les 24h. Le Pathet Lao et ses alliés nord-viêtnamiens suivent de près l’activité du site.
La CIA et son allié principal dans la région du Lima Site 85, le général Vang Pao (5), réalisent que la position est très exposée. 300 mercenaires thaïs, renforcés par des Hmongs encadrés par des officiers paramilitaires de la CIA, assurent bientôt la surveillance de la montagne. En 1967, la position américaine dans le nord du Laos commence à se détériorer après la construction par les Nord-Viêtnamiens, aidés par les Chinois, de routes en dur pour acheminer un soutien logistique au Pathet Lao. Par ailleurs, Phou Phathi prend aussi une importance particulière car elle se trouve au centre d’une région de culture du pavot tenue par les Hmongs eux-mêmes, un revenu financier non négligeable pour les montagnards pro-américains. Vang Pao s’est probablement servi du commerce de l’opium pour financer sa guerre contre le Pathet Lao et les Nord-Viêtnamiens, avec sans doute la participation de la CIA.
Par ailleurs, le Lima Site 85, avec sa zone d’atterrissage pour hélicoptères et sa piste, servait bien avant l’installation de la station de petit poste de commandement pour les Hmongs et leurs officiers d’encadrement de la CIA qui harassaient les communistes dans la région. En 1959, la montagne était tombée entre les mains du Pathet Lao qui s’était servi de Hmongs renégats, ceux-ci étant les seuls à connaître la manière d’escalader « le Rocher ». Fin 1967, la CIA détecte une intense activité près des routes 6 et 19 qui mènent à Phou Phathi. Etant donné que les Nord-Viêtnamiens utilisent les routes pour transporter leur matériel lourd, une offensive semble imminente. En novembre 1967, ce sont pas moins de 19 bataillons nord-viêtnamiens qui sont observés à Samneua, preuve des intentions des communistes à l’égard du « Rocher ».
Cliquer ici pour voir la vidéo.
Un site essentiel à Rolling Thunder vite menacé
En raison de leur dépendance des routes pour le transport, les Nord-Viêtnamiens n’attaquent qu’à la saison sèche, qui au Laos s’étend de la mi-octobre au début-juin. L’US Air Force a alors procédé à une nouvelle amélioration de la TACAN en commençant à installer un système radar d’évaluation des bombardements et des dégâts TSQ-81 COMBAT SKYSPOT. Ce radar, une version modifiée d’un autre utilisé par le Strategic Air Command (MSQ-77), doit permettre d’accroître les possibilités de bombardement par mauvaises conditions météo au Laos et au Nord-Viêtnam (octobre-avril) : il amène les appareils sur un point dans le ciel où ceux-ci larguent leur chargement. Il est opérationnel en novembre, juste à la fin de la saison des pluies. L’offensive communiste commence en décembre, avec de petites embuscades. Mais, le 15, les Hmongs et la CIA détecte une avancée en force sur Nam Bac, position clé de l’armée royale laotienne, et contre Phou Phathi. Deux compagnies du Pathet Lao s’emparent de Phou Den Din, à 12 km seulement à l’est du Lima Site 85, le 16 décembre, position reprise par les Hmongs quelques jours plus tard. L’US Air Force et la CIA dirigent de nombreuses frappes aériennes avec des F-4, F-104 et A-1 contre les troupes ennemies massées autour de la station. Des A-26 d’un Air Commando frappent, de nuit, les routes 6 et 19 pour freiner l’acheminement des troupes. La bataille autour de Nam Bac s’intensifie pourtant en janvier 1968, et, le 14, la ville tombe aux mains de 4 bataillons de réguliers nord-viêtnamiens.
Les opérations aériennes conduites par le TSQ-81, baptisées COMMANDO CLUB, commencent à avoir un impact réel en janvier : à ce moment-là, 23 % des frappes sont guidées par le Lima Site 85. Même par mauvais temps, le radar est capable de conduire avec précision les attaques contre le couloir Hanoï-Haiphong et dans les environs du site Lima lui-même. Ces résultats donnent un surcroît de confiance à l’ambassadeur américain au Laos, William Sullivan, et à la CIA, persuadés qu’une attaque sera déjouée par un soutien aérien rapproché massif tandis que les techniciens seront évacués si besoin par hélicoptère. Ces techniciens reconvertis en civils n’ont même pas le droit d’emporter des armes de poing dans leurs rotations quotidiennes ; des explosifs sont fixés aux antennes et aux installations, bientôt précipités du sommet des falaises par les techniciens qui craignent une explosion accidentelle. Comme aucun détachement militaire américain ne peut être amené pour assurer la garde de l’installation, le Lima Site 85 dépend des deux officiers paramilitaires de la CIA et de leurs 1 000 Hmongs stationnés dans la région. 200 gardent la ligne de crête tandis que leurs 800 camarades sont installés en contrebas, dans la vallée. Ce sont d’excellents combattants de guérilla, mais ils sont peu préparés à la défense conventionnelle d’un site escarpé. Les Américains comptent en fait sur l’appui aérien et l’évacuation assurée par les appareils d’Air America (6) ; mais seul l’ambassadeur Sullivan peut en donner l’ordre. La pression continue de s’accroître en janvier : le 10, les Hmongs repoussent une patrouille de 5 hommes du Pathet Lao au pied de l’escarpement.
L’assaut communiste sur le « Rocher » : la chute du Lima Site 85
Le 12 janvier, la CIA signale une formation de 4 appareils se dirigeant vers le Lima Site 85. Deux appareils rompent la formation mais les deux autres continuent leur route, mitraillant, bombardant et tirant des roquettes en trois passes, à 1h du matin, sur l’installation. Les bombes larguées par les vieux appareils soviétiques sont en fait des obus de mortier de 120 mm modifiés. Plusieurs Hmongs sont tués. Le Forward Air Controller du site et l’officier de la CIA tirent sur les appareils, des Antonov An-2 Colt, et demandent le renfort d’un hélicoptère. Le Bell 212 ouvre le feu à la mitrailleuse sur les intrus et les abat tous les deux. Le 19 janvier, un informateur à Samneua signale qu’une force de 5 bataillons nord-viêtnamiens et du Pathet Lao s’est mise en marche en deux groupes : le premier, fort de trois bataillons et appuyé par un Howitzer 105, se lance sur Phou Den Din, une position clé de la région du Lima Site 85. Le second fort de deux bataillons s’élance au sud-est dans une manoeuvre d’encerclement du « Rocher ».
Sur celui-ci, les communications avec Vientiane sont maintenues grâce au poste de commandement près de l’helipad, à 20 mn des installations radar sur le sommet. Un exercice d’auto-défense du site est mené le 25 janvier : il montre clairement qu’une défense appuyée par l’aviation ne permet pas de tenir l’emplacement. Le personnel de l’USAF prévoit donc une autre route d’évasion en descendant en rappel l’un des côtés de la montagne. Après la chute de Phou Den Din le 22 janvier, les Nord-Viêtnamiens marquent une pause pour se réorganiser. Les Américains dirigent toutes leurs frappes aériennes et celles de l’aviation royale laotienne contre les troupes communistes dans les environs. Le 30 janvier, les communistes font exploser quelques mines défensives aux abords extérieurs du périmètre de défense et pilonnent la montagne au mortier pendant trente minutes. Les Nord-Viêtnamiens s’installent dans une zone de 12 km autour de Phou Phathi. Les engagements avec les Hmongs sont peu fréquents mais impliquent toujours des unités de la taille de la compagnie.
Des informateurs indiquent que les communistes comptent s’emparer du Lima Site 85 fin février, mais le sentiment de confiance ambiant aboutit à ne pas modifier la stratégie américaine. Une rupture de communications qui compromettrait gravement la défense, en particulier, n’est pas du tout envisagée. La responsabilité du destin du site reste entre les mains de l’ambassadeur ou de la 7th Air Force qui pilote les opérations en Thaïlande. Le 18 février, un officier nord-viêtnamien est tué par les Hmongs non loin du site et on retrouve sur son cadavre des documents détaillant l’attaque à venir. L’Air Force réagit en ordonnant des bombardements massifs autour du site, guère efficaces en pleine zone de jungle dense et épaisse. Du 20 février au 11 mars 1968, les raids aériens se multiplient. Fin février, ceux-ci forcent les Nord-Viêtnamiens à s’éloigner pour se regrouper et le plan d’évacuation est mis en place. 3 HH-1 « Jolly Green Giant », 2 Bell 212, pouvant transporter 155 personnes, seront engagés. Les Hmongs doivent aussi être évacués. Les 2 Bell restent en alerte permanente sur le Lima Site 98, tout proche. Les appareils de l’Air Force viendront de Thaïlande. Mais le mauvais temps peut empêcher toute l’opération. 5 techniciens supplémentaires arrivent pour faire tourner le radar 24h sur 24 ; le personnel est désormais armé de M-16, d’armes automatiques et de grenades. Des cordes sont disposées sur la falaise pour une évacuation « de rechange » que l’on ne juge, en fait, que peu probable.
Le 9 mars, les communistes ont fini d’encercler toute l’installation : 4 bataillons du 766ème régiment nord-viêtnamien, dont un du Pathet Lao, sont à pied d’oeuvre. Peu après 18h le 10 mars, un barrage d’artillerie commence. Le 105 utilisé par les Hmongs est touché, tout comme les quartiers du personnel. Les techniciens se réfugient dans les bunkers et abandonnent la radio du TSQ. L’attaque est lancée à la tombée de la nuit pour empêcher l’intervention du soutien aérien américain. Les Hmongs, renforcés par un bataillon thaïlandais de « mercenaires », sont positionnés sur la face sud-est de la montagne. Les Nord-Viêtnamiens lancent un assaut frontal avec trois bataillons de ce côté-là. Mais 33 sapeurs nord-viêtnamiens (7) escaladent pendant ce temps la face nord, lourdement armés (8), pour prendre les Américains par surprise, selon la même tactique qu’en 1959 (9). A Udorn, l’USAF prépare les A-26 d’attaque nocturne du 506th Special Operations Wing. A 19h45, le barrage d’artillerie cesse et les techniciens retournent au radar TSQ. Ils guident les appareils sur d’autres cibles que le Lima Site 85. Quelques F-4 et A-26 frappent les environs du site à 3h20 le 11 mars. A 21h21, le pilonnage a repris, et c’est seulement alors que l’ambassadeur, qui n’a pas mesuré la gravité de la situation, ordonne l’évacuation de 9 des 16 techniciens du site à 8h15 le 11 mars.
Les sapeurs nord-viêtnamiens sont finalement arrivés au sommet dans la nuit et commencent à détruire les bâtiments avec des grenades à 3h45 du matin. Les techniciens du TSQ, alertés par les explosions, sortent du bâtiment opérations et sont pris dans un échange de coups de feu : trois sont tués, dont le commandant de l’installation. Les autres filent vers la falaise. Deux autres techniciens au repos sont tués dans leur sommeil. Autour de l’helipad a lieu un combat féroce entre le commandant du poste de la CIA, Huey Marlow, un ancien Béret Vert, et quelques Hmongs qu’il a sous ses ordres, et de l’autre côté les sapeurs ennemis. L’antenne de la TACAN étant détruite, les communications sont coupées entre 3h et 5h du matin. L’ambassadeur, sans nouvelles, ordonne finalement une évacuation 7h15. Les 2 Bells qui arrivent sur place essuient le feu des sapeurs hmongs au sommet. Marlow demande alors un straffing par des A-1E Skyraiders. Les Bell réussissent ensuite à se poser : ils évacuent les deux officiers de la CIA, le FAC et 5 techniciens dont l’un mourra de ses blessures reçues pendant l’évacuation. 8 des 11 corps seront également ramenés, et des missions Search and Rescue seront menées aussi plus tard pour récupérer les trois autres.
A midi, toute chance de récupérer des hommes supplémentaires étant perdue et une contre-attaque ayant échoué, les Américains se résolvent à détruire le site avant que les Nord-Viêtnamiens ne puissent mettre à profit leur prise. Entre le 12 et le 18 mars, des sorties aériennes sont menées quotidiennement contre le sommet ; et, le 19, deux A-1E nivellent tous les bâtiments encore visibles sur la crête. Ce bombardement a certainement pulvérisé les corps restants des techniciens abattus.
Conclusion
La chute du Lima Site 85 n’est pas la faute d’un renseignement défaillant, mais bien celui d’un système de commandement et de contrôle problématique qui n’a pas permis aux troupes sur place de s’organiser correctement : les techniciens dépendaient des officiers de la CIA et des Hmongs, et n’ont pas mis en place une véritable défense militaire. Ceux-ci ont cependant défendu la position contre l’assaut nord-viêtnamien mais n’ont rien pu faire contre l’attaque surprise du commando de sapeurs nord-viêtnamiens. La chute de la station marque le début d’une offensive de grande ampleur contre les troupes de Vang Pao au Laos : les Hmongs subissent des pertes sévères dans les derniers mois de 1968 et le Pathet Lao avance inexorablement. En septembre 1968, ce sont près de 20 bataillons communistes qui opèrent dans la région de Samneua. Vang Pao veut reprendre le site, mais l’ambassadeur Sullivan s’y oppose fermement et refuse tout soutien aérien. L’offensive lancée par Vang Pao pendant la saison des pluies s’enlise dès la fin juillet. Finalement, avec le soutien de la CIA et de l’USAF, les Hmongs atteignent la base de Phou Phathi le 18 juillet. Mais ils ne peuvent se maintenir au sommet, chassés avec de lourdes pertes par le 148ème régiment nord-viêtnamien. Phou Phathi ne sera jamais récupérée. Le 31 mars, le président Johnson avait annoncé une réduction des frappes sur le Nord-Viêtnam. Le 1er novembre, l’opération Rolling Thunder est définitivement ajournée.
La « guerre secrète » au Laos, et la chute du Lima Site 85, met des années avant d’être dévoilée, en détails, au grand jour. Une première brèche est ouverte par la parution de l’histoire officielle de l’USAF en 1977, qui ne comprend toutefois pas tous les détails relatifs à l’installation, comme le document publié par l’ancien commandant de la 7th Air Force en 1978. Ce silence est très pénible pour les familles des techniciens de l’USAF tués dans ce combat et dont les corps, parfois, n’ont pas été récupérés. La version nord-viêtnamienne de la capture du site, parue en 1996, est traduite en 1998 par le Département de la Défense. L’historien Timothy Castle publie un livre (10) faisant autorité sur la question en 1999 : il interroge en particulier des officiers du Pathet Lao qui affirment que certains Américains ont été capturés, une allégation démentie par d’autres. Une étude de recherche sur le terrain menée sur place depuis 1994 a permis, en 2003, de retrouver des restes humains en contrebas de la falaise du Lima Site 85 qui sont bien ceux des techniciens de l’US Air Force.
Stéphane Mantoux, Historicoblog
Bibliographie et annexes :
John T. CORRELL, « The fall of Lima Site 85 », Air Force Magazine Volume 89, Numero 4, avril 2006.
James C. LINDER, « The fall of Lima Site 85 », Studies Intelligence Volume 38, Numero 5, 1995, p.79-88.
Le site des vétérans américains de la construction, de l’occupation et de la chute du Lima Site 85 (une mine de renseignements).
Le site d’Air America offre également des informations intéressantes pour le sujet.
- Nommée ainsi en raison de la présence de jarres immenses, antiques.
- Opération déclenchée le 14 décembre 1964.
- Opération déclenchée le 3 avril 1965.
- Il entre en service opérationnel en février 1963.
- Voir mon article précédent : Vang Pao : la guerre de reconquête du Laos n’aura pas lieu
- Compagnie aérienne civile créée en 1950, contrôlée par la CIA qui l’utilise pour ses opérations secrètes pendant la guerre du Viêtnam, au Laos et ailleurs.
- 72 officiers, 15 sous-officiers et 15 soldats, dont 6 Hmongs.
- Ils disposent de 3 RPG-2, de 23 AK, de 4 carabines et de deux pistolets K54.
- Ils sont renforcés par une escouade de sapeurs de 9 hommes transportant 7 AK, 1 RPG-2, 1 carabine et 57 grenades à main hongroises plus des charges satchel.
- Timothy N. CASTLE, One Day Too Long : Top Secret Site 85 and the Bombing of North Vietnam, Columbia University Press, 1999, 368 p.
Cet article est repris du site https://www.alliancegeostrategique.o...

 Artiste à l'honneur
Artiste à l'honneur Arts & culture
Arts & culture Contributions
Contributions Droit & finances
Droit & finances Droits de l'homme
Droits de l'homme Emploi
Emploi Environnement...
Environnement... Genre
Genre Intelligence stratégique
Intelligence stratégique Nouvelles technologies
Nouvelles technologies People et faits divers
People et faits divers Recettes du jour
Recettes du jour Sports en Afrique
Sports en Afrique Santé & humanitaire
Santé & humanitaire Un peu de tout
Un peu de tout